article de Gabriela Mocănașu
Un roman aux jeux de pistes, un roman aux jeux d’indices nous propose l’auteur Alexandre Arditti avec son tout récent ouvrage 2024, L’Assassinat de Mark Zuckerberg, aux Editions La Route de la Soie. C’est un roman troublant et déroutant où son auteur nous invite à découvrir, dans une clé à la Voltaire, une fable romanesque du XXIème siècle.
Ce qui intéresse en premier lieu dans un roman serait la narrativité, ce mode d'agencement du raconté, qui se caractérise par la succession, la causalité, la mise en intrigue (selon René Audet). Installé dans le fauteuil du narrateur subjectif, l’auteur nous propose une voie narrative bipolaire qui passe par les deux principaux personnages de sa fiction – le présumé criminel Travis, et Gerbier, à la fois le narrateur (ce dernier dans l’hypostase du commissaire de police qui mène les préliminaires de l’enquête criminalistique). Observons, d’abord, le nom choisi pour l’enquêteur – Gerbier (un premier indice pour ce que le roman réserve au lecteur). Nous n’allons pas faire ici le résumé du récit, pour laisser le lecteur libre du plaisir de savourer l’intrigue jusqu’à son terme. Nous pouvons seulement lui suggérer que le roman comporte vingt-six chapitres (l’un deux s’intitule, précisément, « Intrigue »), et propose une chasse aux pistes de lecture. Les indices conduisent le lecteur dans la dense forêt des langages (verbal, gestuel etc).
L’internet a changé le paradigme de la communication sur notre planète et ce roman se veut une chronique de la psychologie de la Table Rase, une organisation (fictive, rappelons-le) qui lutte contre le lavage des cerveaux, ces derniers pris dans le piège des réseaux sociaux virtuels, et de l’internet, en général. Si les sociologues considéraient, au XXème siècle, que le football était un sport planétaire dans le sens où il était capable de soulever les masses, le XXIème siècle est venu en force avec les innovations liées à l’espace numérique et virtuel. Ce dernier a conquis le monde, surtout à travers le réseau du site facebook – d’où le nom du personnage Travis (celui qui se propose de passer à travers facebook). Travis est le principal présumé tueur
de Mark Zuckerberg. L’enquêteur criminologue Gerbier fait, en même temps, traverser le lecteur par le décodage du bagage de sa propre culture. Gerbier est aussi, ne l’oublions pas, le narrateur subjectif du roman. C’est à travers lui que le récit de cette enquête se fait entendre.
À la lecture, on doit souvent revenir sur les répliques pour arriver à tracer une frontière de style, de manière de penser, de parler, d’idéologie véhiculée entre les idées de Travis et celles de l’enquêteur Gerbier. Le lecteur sent qu’il y a deux fables distinctes qui s’y tressent, le chaud et le froid, mais il n’arrive pas à saisir quel fil en est le rouge et lequel en est le bleu. On dirait que l’auteur commissaire de police a créé un personnage à sa mesure, à ses besoins de communication, pour pouvoir participer à un débat à sa hauteur intellectuelle.
La métaphore de la fenêtre domine de loin le tissu narratif – que ce soit dans l’hypostase d’un écran, d’une lucarne, d’un hublot, de l’objectif d’un appareil photo ou de celui d’une arme, le cadran d’une montre, culminant avec la fabuleuse chute narrative - en double sens, vous allez voir ; ce n’est pas commun ! Le lecteur découvrira un dénouement du roman digne de l’absurde d’Ionesco. C’était Eugène Ionesco qui disait que « le comique étant l'intuition de l'absurde, il me semble plus désespérant que le tragique ». C’est aussi la portée du comique dans cette fin du roman. Le narrateur sort d’une fenêtre à travers une fenêtre. La puissance de l’Windows.
Le roman crée un univers dystopique, comme le narrateur le caractérise lui-même : « Mais il fallait raison garder. Il s’agissait d’un roman dystopique. D’une fiction. Du délire d’un auteur, certes particulièrement inspiré, mais d’un conteur d’histoires à l’imagination fertile. Transposer tout ceci à notre époque me paraissait un peu fort de café et je me demandais si Travis croyait lui-même à ce qu’il me racontait. »
La fiction à l’état pur de ce roman traduit un besoin de refouler un trop plein de culture, d’imagination, de faire évacuer les acquis à travers une invention romanesque distrayante. Ce qui fait la saveur de son ambiance narrative c’est surtout le jeu du langage (verbal, gestuel, la mimique, le regard, le ton de la voix). L’œil du narrateur est subjectif, circulaire, perçant, spiralé : l’enquêteur-narrateur se compare assez souvent soit avec son supérieur, Brémond, soit avec le présumé criminel. Le lecteur ressent comme ambigu cet aller-retour et continue fébrilement à tourner les pages. Le bouquineur a besoin de comprendre qui est cet enquêteur fort de ses compétences et qui, en même temps, se fait tout petit devant son chef : « Aujourd’hui, le message était clair : j’étais sommé de la mettre en veilleuse et d’exécuter les ordres, ce que je fis sans autre forme de cérémonie. » Le lecteur ne s’en lasse pas, sa curiosité a été conquise. L’enquêteur pénètre avec acuité et humour dans les profondeurs psychologiques des personnages pour tenir vivante l’haleine du lecteur. Il joue ainsi avec la tête du lecteur, le sublime pari de son entreprise romanesque.
Revenons aux détails du langage corporel, le nœud de tant de procédés narratifs déployés dans le tissu du récit. Même si le roman contient les tropes conventionnels de l’interrogatoire criminalistique, le regard, le langage gestuel et le ton de la voix sont les détails qui mènent vers une compréhension, vers une nouvelle décision, vers une autre stratégie ou sur une autre perspective de l’enquête. Le narrateur scrute les regards, analyse le ton, les gestes et les mouvements du corps.
Premièrement, l’enquêteur Gerbier réagit et répond par le regard. Le regard lui fournit des indices pour la suite de l’interrogatoire. Par le regard il comprend aussi les pensées du présumé criminel, et les pensées de Jo aussi, sa collègue de travail, par le regard il rassure et manipule : « (je) lui jetai un regard qui voulait dire qu’elle avait probablement raison », « Je levai les yeux, et ma première impression fut que ce type n’avait pas la tête de l’emploi », « Il leva les yeux à son tour et me gratifia d’un regard plutôt réfrigérant, qui signifiait clairement qu’il ne fallait pas le chercher. », « sans le quitter des yeux, je le découvris de plus près à travers les volutes de fumée », « de son front dégringolait une cascade de plis horizontaux parfaitement réguliers, son œil frisait et il arborait à présent le visage enfantin du gamin qui vient de faire une bêtise », « (il) me regarda d’un air entendu » etc. Le jeu des regards est offert au lecteur comme mise du langage, c’est par ce jeu que le narrateur sème des indices. Utiliser le lexique pour traduire des gestes immatériels – c’est l’art tout entier d’Alexandre Arditti qui maîtrise et se crée des moyens narratifs.
Les diverses tonalités de la voix, le rire, les pauses suppléées des regards, et les sons blancs des personnages convoquent une attention particulière de la part du lecteur pour lire les non-dits entre les lignes. L’auteur procède ainsi à une écriture où les mots ont le don de faire relever les inflexions des songes des personnages. Le langage verbal est tout puissant : il peut exprimer, il peut laisser entendre, il peut cacher ou manipuler pour bien ouvrir la voie au jeu romanesque (celui avec le cerveau des autres). Le verbe peut dissimuler (« Je fis mine de ne pas avoir entendu »), et il peut aussi donner des détails anodins à n’en plus finir (« Son apparence était beaucoup plus soignée que la mienne ce qui, il est vrai, n’était pas très difficile :
costume noir probablement sur mesure, bottines en cuir impeccables, chemise blanche déboutonnée, cravate noire en soie – à moins que ce ne soit en viscose –, et rasé de près en dépit des dernières heures plutôt mouvementées qui avaient dû précéder son arrestation. On aurait pu le prendre pour un homme d’affaires respectable… »). Quel paragraphe va attirer le lecteur ? Le narrateur lui donne des détails sur détails, et c’est au lecteur d’y voir le jeu romanesque, le désir le plus ardu du narrateur. Car tout roman se construit forcément sur un désir.
Les conventions sociales du pouvoir trompent, mènent les individus en bateau. L’enquêteur Gerbier est le gage de confiance et d’honorabilité. Brémond, son supérieur, représente lui aussi l’autorité de l’état. Le narrateur nous indique, aussi subtilement qu’il peut le faire par son art de maîtriser la parole, des pistes de lecture, des indices que le lecteur pourrait saisir, s’il accordait au mot son pouvoir authentique. Brémond – « Il souffrait d’un certain manque d’instruction… », phrase qui retrouve son plein sens à la fin du roman. Un indice est donc un maillon de lecture. Jo fait confiance absolue aux deux supérieurs et joue son rôle de copilote dans la salle de l’interrogatoire. Elle est l’innocente de l’histoire, une employée et une collègue de Police sans histoire (« Avec elle, la vie paraissait facile. Une promenade de santé. »). Travis se trouve dans une situation qui ne l’embarrasse pas trop : « L’espace d’un instant, on eut dit quelque caïd tout droit sorti d’un film de Scorsese, mécontent qu’on le retienne au poste pour un vulgaire excès de vitesse. »
Communiquer pour manipuler les secrets de l’intrigue, pour cacher et voiler, et pour maintenir la confiance à la fois, le langage en est capable de tout. Le narrateur maîtrise et crée lui-même ce pouvoir de la parole. « Pour toute réponse, elle obtint une moue dubitative, pantomime que je maîtrisais à la perfection pour signifier à mon interlocuteur que je n’avais rien à lui répondre. » - quelle phrase mouvante et mouvementée de sens, presque baroque ! Le narrateur danse avec ses moyens littéraires – « On joue aux apprentis sorciers, sans en mesurer toutes les conséquences à long terme. »
Tout ce qui manque à ce roman c’est la peur. Aucun personnage ne manifeste la peur, surtout pas le présumé criminel. Il avoue, il assume et fait avec. Quel art de l’auteur que celui de rassurer pour mieux tromper. Prêcher le faux (vis-à-vis du lecteur) pour faire ressortir la vérité – ce sont dans cet aspect la force et la saveur de ce roman.
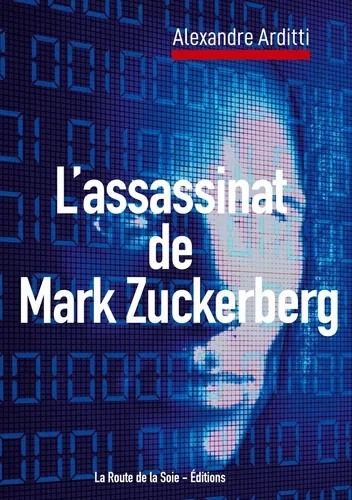
Commentaires
Belle analyse, vous m'avez donné le goût de lire.
Une chronique qui donne envie à lire ce roman prometteur. Merci à vous !